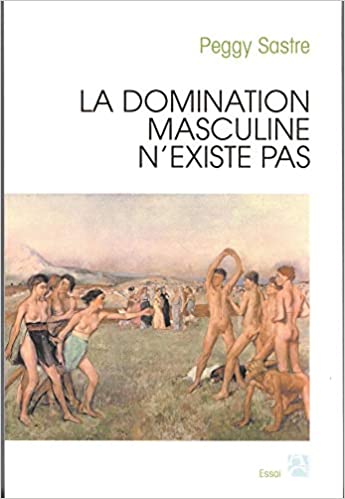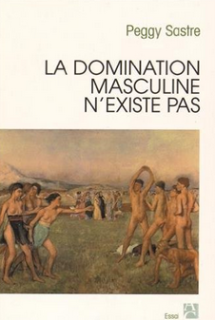La domination masculine existe-t-elle ? La perspective « évoféministe »
NOTRE AVIS SUR CE LIVRE PASSIONNANT ECRIT PAR UNE FEMME :
UN AUTRE ANGLE DE VUE QUE CELUI DES FEMINISTES FRANCAISES QUI ABONDENT DANS LE SPECTACULAIRE ET LEMOTIONNEL.
A TEL POINT QUE CES FEMINISTES FONT BARRAGE AU COMBAT DES HOMMES BATTUS, NOUS LAVONS DEMONTRE EN DEBUT DE PAGE DE NOTRE BLOG, POUR CONSTRUIRE UNE IDEOLOGIE POLITIQUE SUR UNE SOIT DISANTE DOMINATION MASCULINE ACTUELLE.
DONC UN NOUVEAU POINT DE VUE EVOLUTIONNISTE ET DEPASSIONNE SUR CES RAPPORTS HOMMES ET FEMMES.
NOUS PRECISONS QUE NOUS SOMMES POUR LEGALITE HOMMES FEMMES, ET POUR LA CAUSE DES HOMMES ET FEMMES BATTUES, MAIS NOUS COMBATTONS AUSSI LES IDEES RECUES SUR LES HOMMES ET LES FEMMES EN FRANCE QUI PRESENTENT LES HOMMES COMME COUPABLES, DOMINATEURS ET VIOLENTS ET LES FEMMES VICTIMES, DOMINEES ET NON VIOLENTES.
La domination masculine n'existe pas (Français) Broché – 22 octobre 2015
L'homme est une pourriture : c'est lui qui vole, viole, tape, tue, refuse de laver ses slips et préférerait crever plutôt que de vivre dans un monde où des bonniches ont le droit de devenir PDG. Voici la " version officielle " de notre histoire. L'histoire humaine est, dit-on, l'histoire d'une domination masculine, faite par et pour des hommes prêts à tout pour tenir les faibles femmes à leur botte. Sauf que cette histoire est fausse. Du moins en partie.
L'homme (avec un petit h et un pénis de taille variable) est une pourriture : c'est lui qui vole, viole, tape, tue, refuse de laver ses slips et préférerait crever plutôt que de vivre dans un monde où des bonniches ont le droit de devenir PDG. Voici la " version officielle " de notre histoire. L'histoire humaine est, dit-on, l'histoire d'une domination masculine, faite par et pour des hommes prêts à tout pour tenir les faibles femmes à leur botte. Sauf que cette histoire est fausse. Du moins en partie. Si les hommes ont le pouvoir, c'est parce que les femmes l'ont bien voulu, tout au long des 99,98 % de l'histoire de notre espèce. Et ces millions d'années qui nous ont vus devenir lentement ce que nous sommes, elles les ont passés à frétiller du derche au moindre indice de force, de puissance et de brutalité. Pourquoi ? Parce lorsque votre organisme renferme des ovaires et un utérus, que votre reproduction vous fait courir un danger vital aussi extrême qu'indispensable, et que vous vivez dans un environnement hostile, de tels attributs sont encore les meilleurs pour vous protéger, vous et le fruit de vos entrailles, et vous aider à transmettre vos gènes aux générations suivantes.
En d'autres termes, il n'y a pas de domination masculine. Un tel système oppresseur, vertical et unilatéral n'existe pas. Ce qui existe, c'est une histoire évolutive qui aura poussé les deux sexes à des stratégies reproductives distinctes. En décortiquant les principaux territoires de la " domination masculine " – les inégalités scolaires et professionnelles, le harcèlement, les violences familiales et conjugales, le viol et les violences sexuelles, la culture de l'honneur, l'agressivité, la guerre et le terrorisme –, cet ouvrage non seulement les éclaire d'une lumière radicalement nouvelle dans notre paysage intellectuel, mais il permet surtout de mieux les comprendre et de les expliquer, quitte à risquer de saisir, au passage, que les femmes ne s'en sortent vraiment pas si mal...
-----------------------------
INTERVIEW :
La domination masculine existe-t-elle ? La perspective « évoféministe »
Un entretien exclusif avec Peggy Sastre, auteur du livre : « La domination masculine n’existe pas ».
Article paru initialement en 2015.
Vous pensiez tout connaître du féminisme ? Détrompez-vous : Contrepoints vous invite à découvrir ce que la théorie de l’évolution peut dire sur le sujet à travers le dernier essai de Peggy Sastre, La domination masculine n’existe pas.
Pour comprendre ce qu’une analyse rationnelle des rapports hommes/femmes peut donner, nous avons donné la parole à cette auteure engagée et passionnante. Docteur en philosophie des sciences, spécialiste de Nietzsche et de Darwin, ses travaux d’essayiste s’orientent principalement autour d’une lecture biologique des questions sexuelles. En tant que journaliste et traductrice, elle collabore à divers titres de presse (Slate, L’Obs, Buzzfeed).
Vous défendez une version critique du féminisme « officiel ». Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu’est l’évoféminisme et les critiques qu’il adresse au féminisme « plus classique » ?

L’évoféminisme est un féminisme qui, à la fois, prend comme base de travail les sciences de l’évolution et qui est évolutif, dans le sens non strictement scientifique du terme. C’est un féminisme qui n’est pas figé dans ses propositions, ses attendus, et qui se laisse la possibilité d’être amendé si jamais des faits solides viennent atténuer, voire remettre en question leur légitimité ou leur logique. J’ai d’ailleurs encore un peu de mal avec ce terme, mais il me semble meilleur que « féminisme darwinien » – parce qu’on ne peut pas réduire ni arrêter le darwinisme à Darwin – ou « féminisme scientifique », vu que tout et n’importe quoi (et surtout n’importe quoi) peut et a pu se réclamer « scientifique ». C’est un féminisme qui privilégie les faits, la méthode rationnelle et où la perspective militante est secondaire, notamment quand elle est contradictoire avec la réalité observable et mesurable.
Le principal reproche que je fais au féminisme mainstream est de ne pas savoir, ou de ne pas vouloir reconnaître la diversité pourtant assez manifeste des femmes, dans leurs goûts, leurs opinions, leurs objectifs, etc., et d’être moralement très maximaliste (ce qui vaut pour soi vaut pour tout le monde). Le reste en découle : globalement, le procès que je pourrais faire au féminisme majoritaire actuel est un procès en dogmatisme. On est progressivement passé d’un féminisme qui cherchait à améliorer la vie des femmes, notamment en leur permettant d’avoir des droits équivalents aux hommes, à un féminisme d’étiquettes et de tampons (je parle des encreurs, pas des hygiéniques). « Ça » c’est féministe, mais pas « ça ». Un tel truc va être du « bon » féminisme, un autre du « mauvais ». Machin est dans ma clique, ma chapelle, mais pas machine… Personnellement, cela m’épuise et c’est un épuisement qui, à mon avis, est un facteur important du rejet de plus en plus massif que l’on peut observer chez les femmes, jeunes ou moins jeunes, vis-à-vis du féminisme, justement, comme étiquette. Ce phénomène du « féministe, mais » – dont la pointe de l’iceberg est la star qui est tout à fait pragmatiquement féministe, mais qui va refuser de se définir ainsi. Par réflexe, beaucoup de féministes vont y voir « la preuve » de la toute-puissance du « patriarcat » (et s’en donner à cœur joie sur la « traître »), sans jamais s’arrêter deux minutes et se demander comment on a pu en arriver là, car cela demanderait de se remettre en question et de voir qu’elles ont, peut-être, une (grosse) part de responsabilité dans cet éloignement, si ce n’est ce dégoût de plus en plus généralisé.
De même, le fait que les féministes n’arrivent pas, dans leur grande majorité, à reconnaître ce qu’il peut y avoir de « féministement » bénéfique dans les sciences de l’évolution est aussi, à la base, un problème de dogmatisme.
Dans votre dernier essai, vous soutenez que la part d’arbitraire culturel du genre est en fait beaucoup moins arbitraire qu’on ne le pense. Il y aurait donc un fond de vérité dans les stéréotypes comme papa travaille pour gagner de l’argent pendant que maman s’occupe des enfants et du foyer ? Est-ce que cela signifie souscrire au « fatalisme » biologique que dénoncent encore certains critiques « culturalistes » de l’action humaine ?
Tout stéréotype a une part de vérité, sinon il ne serait pas « efficace » comme stéréotype. Mais cette vérité peut être biaisée. L’exemple classique est celui du stéréotype raciste. Quand on dit « les Arabes sont des voleurs » on oublie qu’une grosse part de cette réalité « perçue » est relative, dépendante d’un contexte, la preuve la plus évidente étant que les Arabes ne sont pas l’objet d’un tel stéréotype dans les pays arabes. De un, les plus fraîchement immigrés font souvent partie des plus pauvres, et sont donc les plus à même de recourir au vol. De deux, les plus fraîchement immigrés sont, par définition, les moins assimilés et donc ceux sur qui la méfiance des plus enracinés va être la plus forte : les vols commis par des Arabes vont être davantage remarqués que les autres (et, à l’inverse, les vols commis par d’autres plus facilement oubliés), comme on a l’impression que tous les feux passent au rouge lorsqu’on est en retard. Et là-dessus se greffe un biais de généralisation négative bien connu : il vaut mieux croire qu’un phénomène nocif est plutôt vrai que de croire qu’il est plutôt faux, car les risques d’un faux-négatif sont moindre que ceux d’un faux-positif.
C’est le genre de raisonnement que j’adopte dans mon livre avec les stéréotypes genrés ou sexistes : je recherche quels peuvent être leurs éléments de vérité, les biais qui ont présidé à leur succès, etc., le tout dans une perspective évolutionnaire. Mais il n’y a aucun fatalisme là-dedans, vu que l’un des enseignements centraux du darwinisme, c’est de comprendre que ce qui existe, existe parce qu’il a été une réponse suffisamment efficace à un défi adaptatif posé suffisamment longtemps par un environnement donné (ce que Jacques Monod résumait parfaitement en parlant de double logique du hasard et de la nécessité). Un des plus grands chamboulements cognitifs du darwinisme, c’est de faire comprendre que tout ce qui est aurait pu être autrement – c’est tout le contraire de l’essentialisme. Dès lors, en changeant l’environnement, vous changez les problèmes à résoudre et donc l’efficacité relative des solutions à y apporter. Je ne donnerai qu’un exemple schématique : avec l’avènement de l’ère industrielle, l’humanité est passée d’écosystèmes où la réussite, pour faire court, dépendait très largement de la force, à des écosystèmes où elle dépend bien plus largement de l’intelligence. Contrairement à la force, l’intelligence est mieux répartie entre les sexes – d’où la possibilité croissante qu’ont eu et qu’ont les femmes à progresser socialement, là où les hommes « stéréotypés » se retrouvent de plus en plus handicapés, si ce n’est laissés pour compte.
Vous observez, études à l’appui, que la violence « est un phénomène aussi omniprésent dans les sociétés humaines que proportionnellement masculin ». Au regard de l’évolution, pourquoi émerge cette violence, et pourquoi sont-ce les hommes qui s’en font les principaux porteurs ?
Pour le comprendre, il faut rappeler une petite évidence : pour une dépense énergétique équivalente, la femme produit un ovule par mois, l’homme plusieurs millions de spermatozoïdes par jour. Ensuite, lorsqu’un ovule et un spermatozoïde se rencontrent et que l’œuf est fécondé, le travail de l’homme peut à peu près s’arrêter là, tandis que la femme doit encore en passer par neuf mois entiers de gestation interne, un accouchement périlleux et un temps d’allaitement aussi conséquent que contraceptif pour avoir l’assurance relative de la pérennité de ses gènes. Ce qui fait que non seulement le succès reproductif des hommes est bien plus hétérogène que celui des femmes, mais il est aussi dépendant d’un investissement parental minimal bien moindre.
Et on tombe sur ce que prédit la théorie de Trivers : si, relativement à l’autre, un sexe se caractérise par une plus grande variabilité de son succès reproductif et un moindre investissement parental obligatoire, alors c’est ce sexe qui sera le plus violent. Du fait de leur configuration reproductive, la violence est tout « simplement » plus bénéfique aux hommes. À la fois pour éloigner des concurrents et s’attirer des partenaires, avoir recours à la violence a longtemps été une bonne solution, un bon moyen d’arriver à leurs fins, c’est-à-dire la maximisation de leurs intérêts reproductifs.
Les violences conjugales d’aujourd’hui répondent-elles aux mêmes problèmes posés ?
Les violences conjugales relèvent de la même logique, dans le sens où elles peuvent servir à minimiser les risques reproductifs qu’un homme est seul à pouvoir connaître. Comme ce n’est pas lui qui porte le bébé, il n’est jamais à 100% sûr que ce bébé est bien le sien. Une incertitude de paternité qui a représenté une pression sélective très forte au cours de notre évolution et les données contemporaines montrent que l’énorme majorité des violences conjugales surviennent toujours dans un contexte de jalousie masculine.
Il est donc plus que probable que ces violences aient plusieurs fonctions, toutes liées à des intérêts reproductifs spécifiquement masculins : punir la femme suspectée d’infidélité, montrer l’exemple aux autres femmes, partenaires potentielles, et leur ôter l’envie de tromper, indiquer aux hommes concurrents qu’il ne sert à rien de vouloir planter sa graine dans le jardin du voisin, etc.
Que pensez-vous de la thèse de Pinker dans The Better Angels of Our Nature : Why Violence Has Declined ? La violence décline ou est-il un peu trop optimiste ?
Mon très humble avis est que sa thèse d’un déclin de la violence – où, soit dit en passant, l’égalité croissante des droits des hommes et des femmes fait partie à la fois des causes et des conséquences du phénomène – est des plus solides. À ma connaissance, ses sources sont fiables et je n’ai pas croisé d’anti-thèse convaincante. De toutes façons, il le dit lui-même : la question n’est pas d’être optimiste ou pessimiste, mais d’analyser les données que nous avons à notre disposition.
Marier féminisme et darwinisme est nouveau pour le public français : c’est pourtant l’objet de plusieurs disciplines scientifiques reconnues dans le monde anglophone, et cela depuis des décennies. Comment expliquer le retard des sciences humaines et politiques françaises sur ces sujets ?
J’ai envie de dire que le darwinisme ne passe pas bien en général, et en particulier quand il est appliqué à l’humain. Qu’on se rappelle qu’Edward Osborne Wilson, chercheur dont l’excellence n’est plus à démontrer, a sans doute été le seul scientifique de l’histoire moderne à être physiquement agressé pour ses idées par des activistes politiques. Et des militants de gauche, car c’est aussi assez facile (et pratique) de réserver l’anti-darwinisme à des intégristes illuminés d’obédience droitière si ce n’est néo-fasciste croyant que l’univers a 6000 ans.
En outre, m’est avis que les sciences humaines et politiques françaises souffrent d’un manque général de scientificité, et que le maigre « taux de pénétration » des sciences de l’évolution dans la vie intellectuelle nationale n’est qu’un cas, si ce n’est un symptôme particulier. Il y a trois ou quatre raisons principales à cela.
La première touche directement à l’histoire des idées : la France, avec Lamarck et Bernardin de Saint-Pierre (pour qui « le melon a été divisé en tranches par la nature, afin d’être mangé en famille ; la citrouille, étant plus grosse, peut être mangée avec les voisins ») était sans doute la moins prête des nations européennes à admettre l’anti-finalisme de Darwin. Et on ne rattrape pas ce genre de retard en deux coups de cuillère à pot – sachant que, de toutes façons, la révolution darwinienne ne s’est pas faite du jour au lendemain et qu’elle est encore loin d’être « terminée ».
La seconde, c’est la barrière de la langue : toutes les études darwiniennes, qu’elles soient biologiques ou « extra » biologiques comme l’evopsy, se font en anglais et c’est incroyable de voir comment, même à de hauts niveaux universitaires, les gens ne le lisent pas couramment. Barrière qui se renforce par un chauvinisme linguistique là encore assez franco-spécifique (qui va de « l’anglais c’est élitiste » au complexe d’Astérix : « ne pas parler anglais, c’est résister à la mondialisation ») et qui fait que, basiquement, relativement peu de monde est à même d’avoir accès aux sources. (Et quoi de mieux pour soigner son complexe d’infériorité que de dire « c’est de la merde » face à des trucs qu’on n’est même pas en capacité de comprendre ?).
Troisièmement, cela tient à une espèce d’obsession politique/idéologique, là encore assez franco-française, pour qui il n’y a jamais de recherches neutres – ce qui camoufle aussi une ignorance assez fondamentale de la méthode scientifique – qui fait qu’on adore agiter les heures les plus sombres de l’histoire, comme si la science se faisait toujours aujourd’hui comme on pouvait la faire en 1900-1930. Le raisonnement est le suivant : il y a eu le darwinisme social, l’eugénisme, le racialisme, etc. qui se revendiquaient plus ou moins de la théorie de l’évolution, donc le darwinisme sera éternellement entaché de ses dérives et la méfiance doit être de mise. Qu’importe qu’elles aient été dès le départ scientifiquement fallacieuses, si ce n’est fautives ou que l’eugénisme – pour ne parler que de l’une d’entre elles –, ait été très majoritairement mis en œuvre dans des pays parfaitement démocratiques et en des temps de paix, comme ce qui a pu se passer aux États-Unis ou dans les pays scandinaves.
Les choses sont-elles en train de changer ?
À mon petit niveau, j’ai l’impression que oui. Je vois par exemple passer de plus en plus de noms de chercheurs français dans des études darwiniennes publiées dans de prestigieuses revues internationales, en particulier ceux issus de l’équipe de Michel Raymond. Mais j’ai aussi l’impression d’un hermétisme, si ce n’est d’un mysticisme croissant chez les sciences humaines à la papa, où on se fait un honneur de combattre le « scientisme ». Tant pis pour elles, parce que d’autre côté, l’exigence de scientificité n’a jamais été aussi grande dans des disciplines proprement « humaines » comme peuvent l’être les sciences cognitives. Et, par ricochet, de tels champs de recherche effacent progressivement les frontières « traditionnelles » entre sciences humaines et sciences dures, ce qui n’est vraiment pas un mal.
- Peggy Sastre, La domination masculine n’existe pas, Anne Carrère, octobre 2015, 274 pages.
A découvrir aussi
- LIVRE : Une baffe et çà repart, de Séverine VIALON
- LE LIVRE DE SOPHIE TORRENT
- LIVRE GRATUIT SUR LES HOMMES BATTUS EN FICHIER PDF
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 269 autres membres